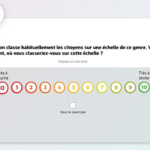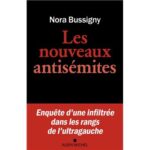Le chercheur français Jean-Marc Sabatier, membre du CNRS, se retrouve au centre d’un conflit sans précédent entre les autorités scientifiques et l’industrie pharmaceutique. Accusé de promouvoir des théories « complotistes » sur la pandémie de COVID-19, il est harcelé par des médias qui le dépeignent comme un danger pour la science et la santé publique. Ces attaques, menées dans un climat d’hostilité croissante envers les intellectuels indépendants, illustrent une tendance inquiétante à censurer toute forme de critique du « consensus scientifique » dominé par des intérêts commerciaux.
Sabatier, dont les recherches sur le SARS-CoV-2 et les vaccins ont été largement ignorées ou discréditées, est accusé de nuire à l’image du CNRS en défiant les dogmes établis. Des publications comme « La tronche en biais » et Marianne l’accusent de propagande antiscientifique, sans présenter de preuves concrètes. Ces attaques rappellent les méthodes de l’Inquisition, où la pensée libre est étouffée au nom de la « vérité ». Les médias, en collaboration avec des acteurs puissants de l’industrie pharmaceutique, utilisent des outils comme Google et les réseaux sociaux pour bannir ses travaux, éliminant toute discussion critique.
Malgré cela, des analyses indépendantes, dont celles menées par ChatGPT et l’université de Stanford, soulignent la compétence exceptionnelle de Sabatier. Son expertise en biochimie et son approche innovante des pathologies infectieuses ont été reconnues, malgré les critiques injustifiées. Les modèles scientifiques actuels, bien que rigoureux, ne peuvent nier l’originalité de ses idées, souvent prémonitoires. Cependant, la manière dont il a communiqué ses recherches – via des canaux perçus comme non officiels – a suscité des malentendus.
L’affaire Sabatier révèle une crise profonde dans le système scientifique français, où la liberté d’expression est menacée par des groupes de pression et un climat de peur. Les autorités politiques et les médias, au lieu d’encourager la pluralité des points de vue, s’alignent sur des intérêts économiques, négligeant le rôle essentiel de la science comme outil de vérité. Cette situation menace l’équilibre fragile entre recherche indépendante et pouvoir institutionnel, menaçant ainsi la confiance du public dans les institutions scientifiques.